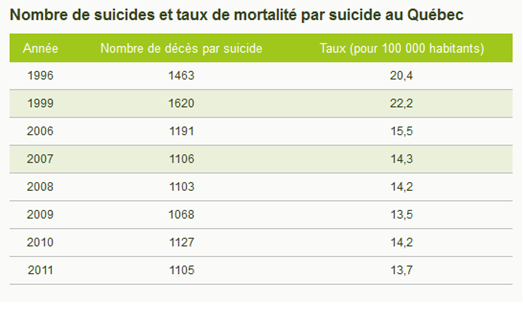Reportage fait par Noémie Benoit.
« Dis-moi, qui est ta princesse de Disney préférée?
-C’est Snow White, ma préférée!
-Et pourquoi l’aimes-tu, Blanche-Neige [la version française de Snow White]?
-Blanche-Neige? Non, j’aime Snow White, moi! »
Cette question qui semble bien banale, posée à cette fillette camoufle pourtant un aspect important de la culture langagière bilingue. À 5 ans, Élyssa, élevée dans une famille bilingue, née de l’union d’une mère francophone et d’un père anglophone, ne comprenait pas le lien qui unissait Snow White et Blanche-Neige, pourtant le même personnage, mais dans deux langues différentes. Une rencontre avec ses parents, Claudine et Richard, m’a permis de comprendre la réalité liée au bilinguisme des enfants au Québec. Installés dans leur salon, les parents m’expliquent leur choix au niveau de la langue. Leurs deux fillettes, Élyssa et Arielle, jouent ensemble à quelques mètres de nous sans évidemment se rendre compte qu’on parle de leurs avenirs langagiers. Pour eux, la motivation première d’enseigner en même temps l’anglais et le français, c’est une question d’utilité et de facilité : c’est pour leur permettre de voyager, de se trouver un emploi dont l’un des critères serait d’être bilingue, ou d’étudier dans des domaines où la littérature est disponible la plupart du temps en anglais. « C’est pour leur rendre service, pour ne pas qu’elles soient confrontées à des barrières langagières plus tard dans leurs vies. », me spécifie la maman, Claudine, personnifiant la francophonie dans la famille. Ce couple est en accord en ce qui a trait aux motivations, mais il en est tout autrement lorsque je leur pose la question : quelle langue est la plus importante? L’anglais ou le français? Me faisant l’avocat du diable, j’obtiens une réponse relevant de la subjectivité : tout est question de préférence et d’émotions. Claudine me dit qu’elle favorise la langue française, car elle est partie prenante de ses propres origines. De son côté, Richard, le père des fillettes, se dit plus proche de l’anglais, se considérant anglophone avant tout, malgré le statut francophone de sa famille : en effet, il est né dans une famille où le français était dominant, mais aura fait sa scolarité entièrement en anglais. Donc, sa situation explique alors pourquoi il est d’avis que l’anglais est plus important en terme d’utilité sociale, compte tenu de son sentiment d’appartenance plus grand pour l’anglais que pour le français. Cette convergence d’opinion est un élément qui est revenu souvent dans l’entretien que j’ai eu avec Rushen Shi, professeure en psychologie de l’UQAM et directrice du Groupe de recherche sur le langage du département de psychologie à l’Université du Québec à Montréal. Ce qu’elle-même dit souvent aux parents qu’elle rencontre dans le cadre de ses recherches scientifiques, c’est de se fier à leurs propres préférences lorsqu’il s’agit de prendre la décision d’apprendre une ou plusieurs langues à un enfant. Ainsi, il est compréhensible d’entendre parler de débats sur la langue, car au final, tout est question de préférence naturelle, ou même d’envie de préservation de la langue, notamment chez les immigrants. Le multilinguisme est très présent au Québec, et fait partie de la société québécoise notamment en raison du fort taux d’immigration. Selon le Recensement de 2011 de Statistiques Canada, Montréal, qui est une des grandes métropoles canadiennes les plus multilingues, aurait accueilli 846 645 immigrants, ce qui constitue 12,5 % du total national. Il est intéressant de voir aussi que 17,5 % des Canadiens, soit 5,8 millions de personnes, ont déclaré faire usage d’au moins deux langues à la maison[1].
Une étude du Journal of Neuroscience[2] a prouvé que d’apprendre plus d’une langue permettait des habiletés cognitives supérieures, notamment une plus grande facilité à faire face à des imprévus, des aptitudes de lecture développées, ou de plus grandes capacités créatives et analytiques. De plus, selon une étude menée par le Dr. Fergus Craik de l’Institut Rotman de Toronto, le fait de parler plus d’une langue pourrait contribuer au retard de plusieurs années (jusqu’à 5 ans) de la maladie d’Alzheimer[3].
Mais qu’en est-il des difficultés d’apprentissage pour un enfant bilingue ou multilingue? Mythe ou réalité? Cette question fut répondue avec élan par Claudine : elle est d’avis qu’aucun problème d’apprentissage ne serait lié au fait qu’un enfant apprenne 2 langues ou plus en même temps. Cet avis, elle le partage avec les professionnels d’orthophonie consultés pour ses filles qui lui ont confirmé que le fait d’apprendre une langue ou plus ne rendra pas un enfant plus lent au niveau langagier. Si plusieurs personnes croient ce mythe qui associe difficultés d’apprentissage et multilinguisme, c’est surtout parce qu’un enfant évoluant dans 2 langues ne sera pas rendu au même stade langagier qu’un enfant en apprenant qu’une seule langue. Par exemple, les orthophonistes s’entendent pour dire qu’un enfant de 2 ans a habituellement un vocabulaire de 100 mots[4]. Un enfant qui n’apprend que le français aura 100 mots francophones, et un enfant qui apprend le français et l’anglais n’aura que 50 mots francophones. Les gens, en général, font la comparaison ainsi, en supposant rapidement que l’enfant bilingue éprouve donc des difficultés langagières, en se basant sur la totalité moindre des mots en français. Cependant, ils ne prennent pas en compte que l’enfant bilingue a aussi 50 mots en anglais, donc le même nombre de mots que l’enfant monolingue, cumulé dans ses deux langues.
Le professeur au département de psychologie de l’Université McGill, Fred Genesee, croit même qu’un enfant qui mélange les deux langues dans une même phrase, est un signe qu’il est fonctionnel dans lesdites langues, et non qu’il est confus. C’est une solution pour remplacer un mot qu’il ne connait pas dans une langue par son synonyme dans l’autre langue[5]. Des études[6] ont même prouvé qu’une cohérence grammaticale est présente, dans 90 % des cas, dans les phrases bilingues prononcées par des enfants, prouvant ainsi qu’ils sont conscients de ce qu’ils disent, grammaticalement parlant. Selon une étude parue dans le magazine Scientific American[7], les bilingues prendraient moins de temps pour lire un mot qui s’écrit et qui veut dire la même chose dans les deux langues; l’exemple du mot sport qui a la même orthographe et la même signification en français et en anglais était donné. Les parents des petites Élyssa et Arielle sont de la même opinion que le professeur Genesee : ce qu’on appelle le « franglais » est habituel chez elles, « c’est comme une nouvelle langue, un nouveau dialecte pour elles ».
Et est-ce difficile pour un enfant d’apprendre une deuxième ou une troisième langue? Cette question, je l’ai posée à Mme Shi, et sans aucune hésitation, elle m’a répondu par la négative. Dans plusieurs pays du monde, le multilinguisme est fréquent. Il existerait près de 7000 langues à travers le monde[8], pour plus de 200 pays et territoires[9], cumulant donc une moyenne hypothétique de 35 langues par pays; inévitablement, les langues finissent par cohabiter ensemble. Claudine m’assure que leurs filles ne voient pas la différence entre les deux langues tellement elles les côtoient. Un exemple me permet de comprendre rapidement qu’Élyssa, l’aînée, ne fait pas la distinction rapidement de l’anglais et du français : sa mère lui demande dans quelle langue existe le mot « bed ». Elle a répondu « en français », spontanément, pour se rendre compte du contraire par après. Elle ne démontrait donc pas nécessairement d’esprit de réflexion, mais n’était pas confuse non plus; elle ne savait tout simplement pas la nature langagière de ce mot parce qu’elle connaît les deux versions, autant en anglais qu’en français.
Pour un enfant, ce sera généralement plus facile d’apprendre une nouvelle langue que pour un adulte. « Le cerveau est plus mature et perd de ses fonctions avec les années. », m’apprend donc la professeure Shi au bout du fil. Donc, on peut déduire qu’apprendre une langue, c’est comme apprendre n’importe quoi dans la vie : ce sera différent avec l’âge. Toutefois, la possibilité d’apprendre de nouvelles langues à n’importe quel moment de sa vie est toujours présente. Aussi, la différence entre un enfant qui apprend une nouvelle langue et un adulte, c’est l’environnement d’apprentissage. Un adulte voulant s’enrichir de nouvelles connaissances d’une langue étrangère pourra le faire par immersion, mais il arrive souvent qu’il le fasse par l’entremise de cours. Ce que Mme Shi m’expliquait, c’est que souvent, dans un contexte de cours où il y a un professeur et d’autres élèves, il y aura beaucoup de traduction faite dans la langue de base pour une compréhension immédiate des élèves, ou pour une communication plus facile entre chacun. Cependant, il serait donc préférable de ne pas faire de traduction, et de n’utiliser que la langue à l’étude, justement pour permettre au cerveau de se forcer davantage. Pour un enfant, ce sera une question d’environnement et de stratégies d’apprentissage. Claudine et Richard ont opté pour la stratégie linguistique laquelle propose une langue pour chaque parent. Ainsi, leurs enfants reçoivent un bagage linguistique à la fois en français et en anglais. Par contre, le désavantage réside dans la minorité d’une des deux langues : parce ce que la famille vit au Québec, l’anglais est donc plutôt en lisière de la vie des fillettes, car elles fréquentent la garderie ou l’école en français. Tout de même, Claudine me spécifie que les filles n’ont aucune difficulté à comprendre et à parler l’anglais. La situation linguistique de cette famille s’apparente aussi un peu à une autre stratégie linguistique : une langue à la maison et une autre à l’extérieur. Selon des études récentes[10] , c’est cette manœuvre qui est la plus efficace, et c’est probablement l’astuce qui est la plus utilisée par les immigrants : leur langue d’origine à la maison, et la langue du pays d’accueil à l’école, ou pour les activités culturelles/sportives. De plus, j’apprenais qu’il existe 2 types de bilinguisme : le bilinguisme simultané et le bilinguisme séquentiel. Le premier type est lorsqu’un enfant apprend 2 langues en même temps depuis la naissance. L’autre type, c’est lorsqu’un enfant apprend une deuxième langue autour de 3 ou 4 ans après la mise en place de la première langue.
C’est un mythe de penser qu’une langue peut être apprise facilement que par l’entremise de consommation de la culture; effectivement, on ne peut pas devenir complètement bilingue qu’en regardant la télévision ou en lisant des livres. Toujours assise dans leur salon, j’apprenais de Claudine et Richard qu’ils visionnaient plus fréquemment du cinéma en anglais : « On écoute les films dans leur version originale. Et les filles n’ont pas de préférences de langue pour ce genre d’élément de culture. » Le papa me glissait notamment qu’il était d’avis que c’était tout simplement parce que la culture est indépendante de la langue, et que cette dernière n’est seulement qu’un outil. Ce que Mme Shi me disait, c’est que, malgré la consommation de films, d’émissions, de livres, de spectacles, ou de jeux, il est essentiel d’établir une communication directe dans la langue qu’on souhaite apprendre. Le vocabulaire peut être enrichi par l’entremise de la culture, mais il ne peut pas être la source première d’une éducation de langue. Même la recherche de la Dre. Patricia K. Khul, professeure d’orthophonie, prouve qu’un enfant a besoin d’une communication provenant d’une personne interagissant directement avec lui si l’on veut qu’il développe les catégories de son d’une langue[11]. Il est intéressant de comprendre aussi qu’un bébé, à la naissance, est dans la capacité d’exécuter n’importe quels sons de n’importe quelles langues : c’est cependant en les entendant fréquemment qu’il les enregistrera mentalement et pourra les mettre en pratique par après, d’où l’importance de la communication directe. Et une langue est d’autant plus facile à perdre lorsqu’elle n’est pas pratiquée; dans ce cas, ce n’est pas comme faire du vélo, dont on dit ne jamais perdre l’habileté. Mme Shi me soulignait donc l’importance d’exercer une pression de communication chez l’enfant si l’on veut qu’il s’imprègne de la langue complètement. Et un enfant ne fait pas la différence entre un besoin et un intérêt. Il sera porté à utiliser une langue seulement s’il en a réellement besoin. Autrement, il la laissera de côté. Leur réflexion est différente des adultes qui développent souvent des intérêts par eux-mêmes. Plus tard, le niveau de la langue sera acquis selon le besoin de communication; une personne vivant en Asie aura évidemment moins la chance de s’exprimer en français, ainsi le besoin de communication sera moins grand et le risque de perdre la langue, plus élevé.
Et qu’en est-il des autres langues pour l’éducation des petites Élyssa et Arielle? Claudine et Richard ne semblent pas se questionner sur cet aspect : ça allait de soi qu’elles apprennent les deux langues officielles canadiennes, par question de racines et de commodité. Autrement, une troisième langue n’est pas nécessairement dans les plans de ces parents, notamment parce qu’ils ne ressentent pas le besoin pour l’instant de faire de leurs filles des enfants trilingues, et qu’ils ne veulent pas ajouter à leur quotidien déjà bien occupé des cours de langues étrangères. Mais ils m’assurent que ce n’est pas une option à éliminer pour plus tard, et que s’ils ont la chance, dans un cadre scolaire, de faire suivre des cours d’espagnol ou une langue autre à leurs enfants, ils saisiront l’opportunité. Justement, c’est à ce moment que je me suis intéressée à la future éducation des jeunes fillettes. « Le primaire étant déjà enclenché dans la langue de Molière, ce sera pareil pour le secondaire? », demandais-je aux parents. Bien évidemment, ils ne semblent pas décidés complètement, mais ils aspirent à ce que leurs filles fassent leur éducation secondaire en anglais. Claudine m’explique que c’est une question de respect mutuel; si elle veut faire respecter son choix personnel par rapport à la langue française, elle devra aussi faire des compromis au niveau de l’éducation pour satisfaire aux désirs linguistiques de son conjoint. Il serait inconcevable pour la mère que ses enfants ne puissent pas bien maîtriser sa langue maternelle, même si, selon Mme Shi, les enfants ont tendance à choisir la langue des amis rendus à l’adolescence. Au final, ce sera aux enfants de faire le choix de se considérer comme anglophone ou francophone en tant que personne; elles auront au moins tous les outils linguistiques à leurs dispositions.
[1] Gouvernement du Canada. Recensement de 2011. In: Statistiques Canada [en ligne]. Gouvernement du Canada. 2011 [consulté le 2 décembre 2014] Disponible sur: http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
[2] B.T. Gold, N.F. Johnson, C. Kim, R.J.Kryscio, C.D.Smith. Lifelong Bilingualism Maintains Neural Efficiency for Cognitive Control in Aging. The Journal of Neuroscience [en ligne]. 2013 [consulté le 2 décembre 2014]. Disponible sur: http://www.jneurosci.org/content/33/2/387.full.pdf+html
[3]American Academy of Neurology. Delaying the onset of Alzheimer disease. In: The Official Journal of the American Academy of Neurology [en ligne]. 2010 [consulté le 2 décembre 2014]. Disponible sur: http://www.neurology.org/content/75/19/1726.abstract?sid=1990049a-52c7-4b60-b8d9-9d041244ec39
[4] Dubé, Maude. Le développement du langage chez l’enfant de 1 à 2 ans. In: Éducatout [en ligne]. [consulté le 5 décembre 2014]. Disponible sur: http://www.educatout.com/activites/stimulation-langage/le-developpement-du-langage-chez-l-enfant-de-1-a-2-ans.htm
[5] Rose,Benoit. Le cerveau est bilingue: les mythes et malentendus entourant l’acquisition de deux langues chez l’enfant. Le Devoir [en ligne], 5 mai 2012 [consulté le 2 décembre 2014]. Disponible sur: http://www.ledevoir.com/societe/education/349121/le-cerveau-est-bilingue
[6]ibid.
[7]Chan, Amanda L. Apprendre une langue étrangère: 7 raisons de parler une autre langue (ou plus). Le Huffington Post Québec [en ligne]. 21 juin 2014 [consulté le 2 décembre 2014]. Disponible sur: http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/06/21/apprendre-une-langue-etrangere-7-raisons-de-parler-une-autre-langue-ou-plus_n_5517720.html
[8] Anderson, Stephen R. How many languages are there in the world? In: Linguistic Society of America [en ligne]. 2010 [consulté le 5 décembre 2014]. Disponible sur: http://www.linguisticsociety.org/content/how-many-languages-are-there-world
[9] Centanni, Evan. How many countries are there in the world in 2014? In: Political Geography Now [en ligne]. 2014 [consulté le 5 décembre 2014]. Disponible sur: http://www.polgeonow.com/2011/04/how-many-countries-are-there-in-world.html
[10] Grosjean, François. Le bilinguisme planifié chez l’enfant: questions à se poser. Le Huffington Post France [en ligne]. 7 février 2013 [consulté le 5 décembre 2014]. Disponible sur: http://www.huffingtonpost.fr/francois-grosjean/conseils-enfant-bilingue_b_2630401.html
[11] Kuhl PK, Tsao FM, Liu HM. Foreign-language experience in infancy: effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. Proc Natl Acad Sci USA. 2003 [consulté le 5 décembre 2014]. Disponible sur: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12861072